Le Royal Opera House
Pendant mon séjour en Italie, plusieurs de mes camarades faisaient carrière en Angleterre, au Royal Opera House Covent Garden. Jon Vickers et Louis Quilico y étaient, et surtout mes bons amis Joseph Rouleau et André Turp.
Les Maîtres chanteurs de Wagner
En pleine répétition de Die Meistersinger de Wagner à Covent Garden, le grand chef d’orchestre Rudolf Kempe est soudainement pris d’un malaise grave sous nos yeux. Comme ma voiture est stationnée tout près de l’entrée des artistes, je descends immédiatement de scène pour le conduire à l’hôpital. Les médecins diagnostiquent une thrombose.
Notre bon Reggie Goodall prend sa place au pupitre pour la dernière semaine de répétition. Mais le soir de la première, qui voit-on arriver dans la grande salle rouge et or? Le grand monsieur Kempe, sorti de l’hôpital pour venir diriger. Les machinistes lui avaient fabriqué un fauteuil spécial et un support pour sa jambe. Ce soir-là, Kempe a dirigé assis sans bouger les bras. Un opéra de Wagner! Pendant CINQ heures, il a signalé les entrées à tous les chanteurs avec sa tête … Inoubliable. Sur scène, à la fin, tout le monde pleurait.
Du petit B & B où Aline et moi nous installons à notre arrivée à Londres, je téléphone aussitôt à André et Joseph. Salut, vous deux, comment ça va? Y aurait-il moyen d’auditionner pour le ROH?
La réponse est positive. Pas plus tard que le lendemain, l’agent de Joseph et André, John Coast, me présente à la direction de Covent Garden. Je décline mon répertoire. Pour l’audition, qui a lieu sur-le-champ, mes amis ont eu la bonne idée de retenir les services de Bob Keys, leur meilleur coach. Tout se passe bien. Après l’audition, pendant que Coast délibère de mon sort avec la direction, Joseph et André font les cent pas avec moi dans le couloir.
Le surlendemain, ça y est, je suis membre de la grande Maison. Dans trois semaines à peine, je ferai mes débuts dans La Bohème aux côtés de mes copains. Rouleau, Savoie, Turp, nos noms s’enchaînent dans l’ordre de l’alphabet (un peu plus tard, Louis Quilico est venu allonger la chaîne: Avant toute chose, cependant, il faut nous loger convenablement. Comme André et sa femme Yolande, Aline et moi préférons la banlieue. Les femmes sont très copines depuis nos aventures italiennes. Aussi partons-nous tous les quatre à la chasse aux maisons dans le joli coin de Wembley (le Wembley du célèbre stade), où habitent déjà nos amis. Après quelques recherches, nous achetons une petite maison de type Tudor au 51 Preston Road. Devant l’air médusé de nos voisins, nous faisons aussitôt installer le chauffage central, du jamais vu à Wembley. Pas pour nous, merci beaucoup, le charbon qu’il faut allumer dans chaque pièce et les chambres à coucher où il fait dix degrés. Je n’ai pas envie d’attraper la grippe dans ma propre maison.
 Une nouvelle firme, la Wembley Central Heating, vient par un heureux hasard d’ouvrir ses portes dans le quartier. Je suis son premier client. Deux de ses représentants se présentent chez nous pour prendre les mesures des pièces à chauffer et examiner les lieux. Notre maison, comme c’est la norme, n’a pas de sous-sol. Il faut donc déterminer l’emplacement des calorifères et de la chaudière.
Une nouvelle firme, la Wembley Central Heating, vient par un heureux hasard d’ouvrir ses portes dans le quartier. Je suis son premier client. Deux de ses représentants se présentent chez nous pour prendre les mesures des pièces à chauffer et examiner les lieux. Notre maison, comme c’est la norme, n’a pas de sous-sol. Il faut donc déterminer l’emplacement des calorifères et de la chaudière.
La chaudière au gaz naturel fabriquée par la W C. H. ressemblait à une machine à laver. Destinée à trôner au rez-de-chaussée, elle avait un beau fini en émail blanc éclatant. Au grand choc des employés, je leur demande de l’installer dehors, dans l’armoire à charbon … Ils n’y comprennent rien, un si beau meuble! Pour moi, n’importe quel engin au gaz présente un risque d’explosion. Nos bons voisins, quant à eux, ne voient pas comment le système peut tenir à 22 degrés toutes les pièces de la maison en même temps. Ils n’ont jamais rien vu de tel.
À Londres, on ne voit pas souvent de neige. Il en tombe un centimètre ou deux de temps en temps, mais elle fond tout de suite. Pendant l’hiver de 1964, nous recevons les quelques flocons habituels; en revanche, le thermomètre reste sous la marque du zéro pendant deux semaines d’affilée, et la neige se transforme en glace. Pour les Anglais, c’est le deep freeze. Leurs maisons n’étant pas très bien isolées, il y fait très froid. Cet hiver-là, nos voisins incrédules nous rendent maintes visites.
Londres est plutôt censée être une ville de pluie et de brouillard. Elle ne mérite pas vraiment cette réputation. J’y ai vécu pendant sept ans et j’admets qu’il pleut, qu’il bruine et qu’il fait du brouillard, mais pas plus qu’à Paris, la « Ville lumière ».
Je serai quand même honnête. Une fois, j’ai été victime d’un brouillard londonien. Un vrai. Un brouillard qui a duré quatre jours.
En Angleterre, comme partout en Europe, je me déplaçais en voiture. Non seulement pour circuler mais aussi pour préserver mon équilibre mental: dans mon auto, je méditais, je me détendais, je vocalisais, je me concentrais, j’évitais les foules porteuses de microbes.
En sortant de Covent Garden, un soir vers 17 heures, je m’aperçois que le brouillard couvre la ville mais ne m’en soucie pas trop. Ça ira pour rentrer à la maison, je n’ai qu’à être prudent, me dis-je, et à rouler lentement. Mais, ce jour-là, le trajet de retour, qui dure normalement une demi-heure, se transforme en un cauchemar de quatre heures. Le brouillard est tellement épais que les conducteurs font marcher les passagers devant la voiture pour qu’ils leur indiquent le chemin. Les fameux autobus rouges à deux étages, les double deckers, font de même. C’est le préposé aux billets qui guide le bus à travers la soupe aux pois.
Vers 20 heures, la nature ne pouvant plus attendre, je pisse dans la rue, au beau milieu de Londres, sans un seul témoin! Une heure après, j’arrive enfin à Wembley mais c’est à peine si je distingue l’allée de stationnement. Le nuage gris foncé a même pénétré jusque dans la maison.
Pauvre souffleur !
Bob Keys, le meilleur coach de Covent Garden, prenait place à l’occasion dans la boîte du souffleur.
Je me souviendrai toujours d’un Cav & Pag (raccourci pour Cavalleria rusticana et I Pagliacci, œuvres courtes qui sont très souvent mises à 1’affiche ensemble) où je chantais le rôle d’Alfio dans Cavalleria.
J’arrive en scène dans une charrette tirée par un cheval, un vrai. À l’avant-scène, donc juste en face de la boîte du souffleur, j’arrête l’animal et descends du tombereau pour chanter mon air. Puis j’enchaîne avec un long récitatif. En revenant vers la charrette, j’aperçois du coin de l’œil un Bob Keys affolé, en train d’essuyer frénétiquement sa chemise d’une main tout en tenant la partition ouverte de l’autre.
Comme beaucoup de scènes de théâtre, celle de Covent Garden est inclinée. On me voit venir, j’imagine … Le cheval s’était vidé la vessie sur scène et la rigole coulait directement dans le trou du souffleur. Dépassé par les événements, mon Bob avait mis ses bras autour de la partition pour la sauver du déluge!
Le lendemain, je suis allé à la pharmacie m’acheter un masque pour me protéger de la pollution et j’ai pris le métro!
Ces petits inconvénients mis à part, j’adorais Londres et les Anglais, que je trouvais charmants et, surtout, «civilisés». La mauvaise opinion que les gens ont des Anglais chez nous n’est pas fondée. Ce n’est pas vrai qu’ils sont froids. Ils ont une certaine réserve, ce n’est pas pareil, et un haut degré de courtoisie que nous aurions parfois intérêt à leur emprunter!
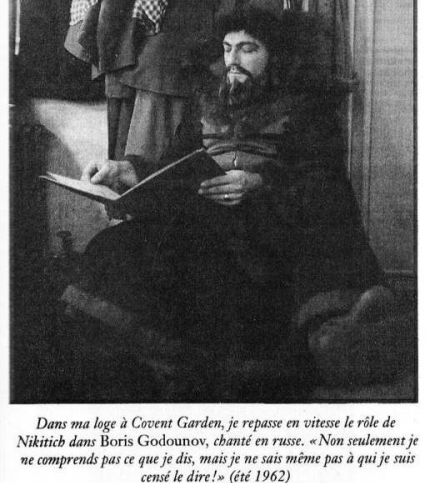 Comme on l’imagine, le Royal Opera House était une maison bien organisée. (On l’appelle Covent Garden parce que l’Opéra se trouve dans le quartier de Covent Garden, un genre de marché Atwater.) Il s’y trouvait une dizaine de coachs – des répétiteurs spécialistes – pour faire travailler les chanteurs, en plus des chefs d’orchestre résidants. En mars de chaque année, la direction annonçait la programmation et les distributions des opéras pour les douze mois à venir. L’horaire de la semaine – répétitions, générales, représentations – était affiché au babillard tous les vendredis, de même que les noms des coachs qui nous étaient assignés.
Comme on l’imagine, le Royal Opera House était une maison bien organisée. (On l’appelle Covent Garden parce que l’Opéra se trouve dans le quartier de Covent Garden, un genre de marché Atwater.) Il s’y trouvait une dizaine de coachs – des répétiteurs spécialistes – pour faire travailler les chanteurs, en plus des chefs d’orchestre résidants. En mars de chaque année, la direction annonçait la programmation et les distributions des opéras pour les douze mois à venir. L’horaire de la semaine – répétitions, générales, représentations – était affiché au babillard tous les vendredis, de même que les noms des coachs qui nous étaient assignés.
La première année j’ai participé à 22 opéras. À cette époque, je connaissais une soixantaine de rôles. (Comme je ne cesse de le répéter aujourd’hui à mes élèves, il faut un solide répertoire pour s’ouvrir les portes des théâtres lyriques.) Les collègues étaient formidables. En qualité de chanteurs résidants – un concept qui a malheureusement presque disparu de nos jours -, nous avions le sentiment exaltant de travailler ensemble au succès d’une maison d’opéra vénérable, établie depuis plus de deux cents ans. Nous foulions la même scène que les Caruso, Albani et Donalda. Mieux, Mme Donalda, mon professeur, avait fait ses débuts londoniens dans La Bohème elle aussi, dans le même théâtre et le même décor que moi, soixante ans plus tôt. À cette pensée, je me sentais grandir d’un mètre.·
En plus des rôles dont nous étions titulaires, il fallait doubler, c’est-à-dire nous préparer pour le cas où un autre chanteur tomberait malade. À Covent Garden, il m’est arrivé quatre fois de remplacer un collègue à la dernière minute.
À l’une de ces occasions, on me demande de chanter, en russe, le rôle de Nikitich dans Boris Godounov. Comme doublure, j’avais mémorisé les paroles en perroquet, mais de là à comprendre les subtilités du texte … A l’appel de la direction, je me présente à la répétition générale : «Non seulement je ne comprends pas ce que je dis, dois-je informer le metteur en scène, mais je ne sais même pas à qui je suis censé le dire! »
Aïda
Charles Craig, notre noble prince Radamès de Covent Garden, est malade et personne en Angleterre ne peut le remplacer. La direction est obligée de faire appel à un ténor hollandais.
A la répétition avec orchestre, devant toute la distribution, le ténor entonne sa première phrase: «Se quel guerriero io fossi, se il mio sogno si averasse» (Si j’étais ce guerrier, mon rêve pourrait se réaliser). Ce qui, dans sa bouche, donne: The quel guerriero io foth-thi, the il mio thogno thi averath-the. Le chanteur zézaye!
Le chef d’orchestre, ennuyé par son défaut de prononciation, le reprend: «Non pas comme ça, voyons! Il faut dire: The quel guerriero io foth-thi, the il mio thogno thi averath-the!»
Aïe, aie, aïe, le chef zézaye aussi!
« Vous vous moquez de moi? s’impatiente le ténor.
– Non, pas du tout. Je vous montre comment on prononce cette phrase en italien! »
Et le chef répète la phrase en zézayant. Le ténor se concentre et répète lui aussi. Le chef s’écrie encore: «Je vous ai dit que ce n’est pas ça! Écoutez! THE QUEL GUERRIERO IO FOTH-THI, THE Ll MIO THOGNO THI AVERATH-THE!»
Tout le monde se bidonne, y compris les choristes. Et voilà qu’ils décident d’achever le pauvre ténor en lui servant une petite humiliation de leur cru. Quand, à la fin de l’opéra, Radamès est emmuré vivant dans son tombeau, le chœur est en coulisse. Au lieu de «Radamès! Radamès! », on entend les voix invisibles lancer un vibrant « What a mess! What a mess!»
Un autre qui n’est jamais revenu …
Les soirs où les chanteurs n’étaient pas sur scène, il leur était permis d’assister aux représentations depuis le staff box, situé juste au-dessus de l’orchestre.
De là nous pouvions tout voir, tout entendre et tout apprendre. Ma passion était de regarder travailler les grands chefs d’orchestre: Otto Klemperer, Rudolf Kempe, Josef Krips, Carlo Maria Giulini et Georg Solti, parmi d’autres. Les plus grands metteurs en scène défilaient également au Royal Opera House: Franco Zeffirelli, qui y a monté notamment Falstaff et Rigoletto, Peter Ustinov (L’Heure espagnole), Sam Wannamaker (La Force du destin), etc. Les occasions pour les chanteurs d’enrichir leur expérience musicale et dramatique étaient légion. Il n’en tenait qu’à nous de les cultiver.
Pas de commentaire