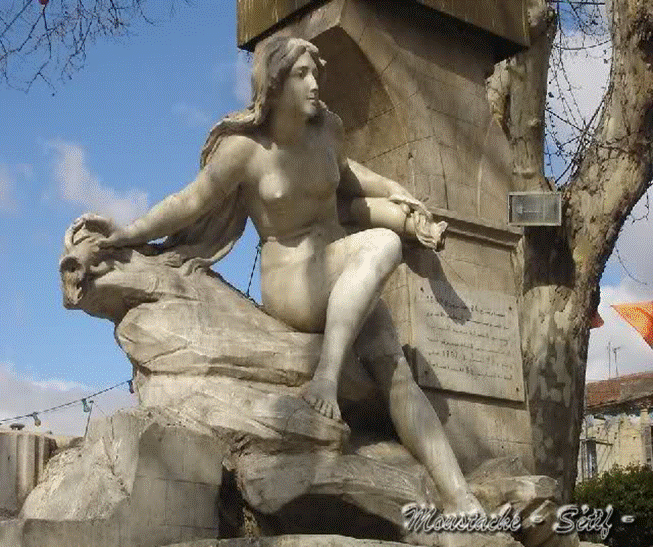 Pour dire la vérité, le premier moment d’euphorie passé, il avait bel et bien été pris d’un doute : fallait-il vraiment entreprendre ce voyage, auquel il rêvait depuis des années. Et la question s’était alors imposée, lancinante : était-ce, dans le fond, une bonne idée ? Il dut bien reconnaître, en son for intérieur, que les mises en garde n’avaient pas manqué. Personne dans son entourage ne l’avait réellement encouragé, c’est le moins que l’on puisse dire : ni ses propres enfants, ni ses copains de l’association, ni même ses amis d’enfance avec lesquels il avait gardé le contact au fil de toutes ces années qui avaient suivi le grand chambardement (plus de cinquante ans au compteur, ce n’était pas rien !) Il y avait eu d’abord les surpris : « alors là, Pierre, tu m’épates, retourner là-bas, après tout ce temps, mais enfin, pourquoi ? Quel intérêt ? ». Et puis les inquiets : « Tu plaisantes, j’espère ! Tu ne seras pas forcément le bienvenu. On va te regarder comme un Ovni. Qu’est-ce que tu t’imagines ? Qu’ils vont te dérouler le tapis rouge ? Ils vont te fermer la porte au nez, oui ! ». Et enfin les carrément contre : « Ne fais surtout pas ça, Pierre ! Tu vas être épouvantablement déçu. Tu vas rentrer complètement déprimé. Crois-moi : tu vas le regretter pendant le restant de tes jours ! Ne fouille surtout pas le passé : il est derrière toi, comme il est derrière nous! C’est de l’histoire ancienne ». Tous étaient unanimes : pourquoi maintenant, comme ça, sans raison, sans prévenir ? « Tu as tiré un trait, comme la majorité d’entre nous. Et ça fait un bail en plus ! Alors basta ! La page est tournée, ne réveille pas les fantômes ».
Pour dire la vérité, le premier moment d’euphorie passé, il avait bel et bien été pris d’un doute : fallait-il vraiment entreprendre ce voyage, auquel il rêvait depuis des années. Et la question s’était alors imposée, lancinante : était-ce, dans le fond, une bonne idée ? Il dut bien reconnaître, en son for intérieur, que les mises en garde n’avaient pas manqué. Personne dans son entourage ne l’avait réellement encouragé, c’est le moins que l’on puisse dire : ni ses propres enfants, ni ses copains de l’association, ni même ses amis d’enfance avec lesquels il avait gardé le contact au fil de toutes ces années qui avaient suivi le grand chambardement (plus de cinquante ans au compteur, ce n’était pas rien !) Il y avait eu d’abord les surpris : « alors là, Pierre, tu m’épates, retourner là-bas, après tout ce temps, mais enfin, pourquoi ? Quel intérêt ? ». Et puis les inquiets : « Tu plaisantes, j’espère ! Tu ne seras pas forcément le bienvenu. On va te regarder comme un Ovni. Qu’est-ce que tu t’imagines ? Qu’ils vont te dérouler le tapis rouge ? Ils vont te fermer la porte au nez, oui ! ». Et enfin les carrément contre : « Ne fais surtout pas ça, Pierre ! Tu vas être épouvantablement déçu. Tu vas rentrer complètement déprimé. Crois-moi : tu vas le regretter pendant le restant de tes jours ! Ne fouille surtout pas le passé : il est derrière toi, comme il est derrière nous! C’est de l’histoire ancienne ». Tous étaient unanimes : pourquoi maintenant, comme ça, sans raison, sans prévenir ? « Tu as tiré un trait, comme la majorité d’entre nous. Et ça fait un bail en plus ! Alors basta ! La page est tournée, ne réveille pas les fantômes ».
Au bout du compte, il avait, bel et bien, été à deux doigts de renoncer. La pression était trop forte. Mais l’obsession elle aussi. Elle était là, tenace. Il en perdait le sommeil. Alors une nuit, il s’était levé en jurant : Barka ! (Comme il le dira plus tard : la rabia, elle m’avait pris !). Un coup d’œil au réveil : quatre heures du matin ! Aouah ! Il fallait au moins qu’il sache si le projet était réalisable, s’il était compatible avec son budget modeste de retraité du Crédit Mutuel. Il passa plusieurs heures devant son ordinateur à se renseigner sur les moyens de transport, sur les billets » low cost », à étudier les horaires, à consulter les tarifs des hôtels, à essayer de situer leurs adresses, devenues mystérieuses, dans les repères de sa mémoire. Hélas la ville, « sa » ville, était devenue « terra incognita ». Il y avait eu tellement de changements au cours d’un demi-siècle. Ses petits-enfants lui avaient montré lors du dernier Noël comment naviguer sur Google Earth. Mais il avait du mal à reconnaître les rues, à retrouver les monuments, pourtant familiers. Il n’empêche qu’au bout de deux semaines (la rabia toujours !), il avait bel et bien bouclé son voyage. Il n’en parla à personne, se contentant d’annoncer une absence de quelques jours, sous le prétexte bidon d’une invitation par un vieux copain de régiment à des sorties de pêche au gros au large de Sète. Et puis le grand jour arriva.
C’était un mercredi de mai. Le ciel était voilé, ce qui le contraria. Il prit un taxi pour l’aéroport. Il s’était ménagé du mou. Ce n’était pas le moment de louper son vol prévu à 15 heures! D’autant qu’il n’avait pas l’habitude de ce genre d’expédition. Pour tout dire : c’était même la première fois. Mais tout se passa bien. Sauf pour ce qui concerne la contemplation du paysage (lui qui était tout content d’avoir eu un siège à côté d’un hublot sur la gauche de l’appareil !). Il eut à peine le temps de se repérer vaguement au dessus du grand étang qu’il connaissait pourtant si bien. Et puis virage à gauche, son avion transperça rapidement le matelas nuageux, pour se retrouver en plein lumière. Il en fut réduit, en maugréant, à baisser à moitié le store de sa fenêtre. Le commandant de bord annonça la durée de vol : 1 h 30. Aucun retard prévu, pas de turbulences. Cela le rassura, mais la contemplation monotone de la couche de nuages le fatigua vite. La lente dégustation de sa bière préférée proposée par l’hôtesse fit le reste. Il s’endormit à moitié. Ce fut l’annonce rituelle du commencement de la descente qui le tira de sa rêverie. Il constata avec joie que la couche s’était très largement morcelée. On voyait de larges zones du sol. Il n’en détacha plus son regard, comme hypnotisé. Il buvait littéralement ce paysage comme on boit à une source que l’on croyait définitivement tarie. Les fermes, les zones cultivées se succédaient, avec, de place en place, des petits groupes d’habitations au milieu de bouquets d’arbres. L’avion descendait plein ouest, et puis, soudain, il amorça un long virage à droite à 180 degrés. Ce fut alors qu’un massif montagneux apparut, qu’il reconnut aussitôt : « les Babors !». Il ne put s’empêcher de dire tout haut : « je vois le Mégris ! ». C’était le sommet qui avait dominé son horizon d’enfant. Bientôt l’appareil fut dans l’axe de la piste. Le sol se rapprochait. Il voyait défiler des bâtiments annexes, des camions à l’arrêt. Soudain il passa au-dessus d’une autoroute et de son échangeur, côtoyant une route nationale qui lui parut par contre familière. « Ah ben, ça ! Ils ont fait une autoroute ! ». Et puis ce fut le choc des roues sur la piste. L’une des hôtesses se leva au bout du couloir. « Nous venons d’atterrir à Sétif. La température extérieure est de 22 degrés ». Il se pinça comme pour se dire qu’il ne rêvait pas. Il y était … Il était revenu à Z’dif, baptisée ainsi en berbère en reconnaissance de ses terres noires fertiles. Des terres que ses ancêtres avaient, eux aussi, défrichées et labourées, à la sueur de leur front. Mais ça, c’est une autre histoire. Une histoire qu’on n’apprend plus…
Il se retrouva dans le hall d’un aéroport inconnu, mais avec pourtant l’impression paradoxale d’être replongé plus de cinquante ans en arrière. Mêmes parfums (le fruit de son imagination sans doute ?), même brouhaha (qui n’était pas tout à fait celui de la Canebière), même fond musical, international, impersonnel. AÏn Arnat, le « Marignane » du coin, n’était pas loin du centre ville. Il fit le choix néanmoins de prendre un taxi. Le chauffeur (un chibani kabyle, se dit-il, en souriant intérieurement, bref un « vieux ») marqua quelques secondes d’étonnement. Et puis d’anciens réflexes surgirent spontanément, avec un brin d’ironie : « j’te conduis où, Patron ? ». Il donna l’adresse relevée un peu au hasard, lors de sa quête sur internet : Hôtel El Rabie, place de l’Indépendance. Une façon un peu provoc’ de jouer le jeu, si l’on peut dire, en espérant que la place en question correspondait bien à une petite idée qu’il en avait derrière la tête.
Son taxi, une vieille 504, s’inséra dans la circulation. L’autoradio diffusait en boucle de la musique raÏ. Il se surprit à s’en laisser imprégner, comme pour favoriser et goûter le charme de la redécouverte. Il savait qu’il était sur la Nationale 28 et qu’il n’y avait qu’à se laisser aller. Au bout il y aurait l’Avenue Anatole France et la Place Bir Hakeim, et il serait, enfin, au terme du voyage. Mais il dut rapidement se rendre à l’évidence : il ne reconnaissait rien. Evanouie, la grande plaine agricole de sa jeunesse, que dominait, sur son promontoire, la statue de « Notre Dame de la Paix », la Maabouda, « l’Adorée » pour les musulmanes en désir d’enfant qui venaient accrocher aux buissons voisins des petits ex-voto en tissu, afin que leurs vœux s’accomplissent. Le bahut roulait sur un boulevard à deux voies, bordé d’immeubles anonymes et de lotissements, comme il en pousse un peu partout à la périphérie des villes. Le trafic était dense, désordonné, les coups d’avertisseur fréquents, les deux-roues imprévisibles…Il se dit que finalement, ça ne le changeait pas tellement de sa propre banlieue. Et puis soudain, ce fut le choc. L’avenue se rétrécissait en s’incurvant vers la droite. Elle devenait familière, il en était sûr ! Son regard sautait de sa vitre au pare-brise, dans un manège qui n’avait pas échappé au chibani du volant, qui n’en perdait pas une miette dans son rétroviseur. Il réussit à choper l’inscription d’une plaque au passage : Avenue Abache Amar. Mais non ! Il en aurait mis sa main à couper. C’était bel et bien l’Avenue Anatole France. D’ailleurs, tiens, le bahut débouchait sur la Place Bir Hakeim. Sauf que, déception, elle était méconnaissable : un rond-point impressionnant qui régulait un trafic à deux voies encerclant littéralement le cœur de la vieille ville de son enfance. Mais elle était bien là, la vieille ville, juste en face, et le taxi s’engagea enfin dans ses rues tirées au cordeau. Et là, pour le coup, il aurait pu prendre le volant : tout droit, puis première à gauche sur le tracé des anciens remparts, et enfin à droite. Son hôtel, il en était sûr, était à deux pas, tout près de la mosquée (il l’avait choisi exprès). Son cœur se mit à battre un peu plus vite lorsqu’il vit le minaret. « C’est la mosquée El Atik, patron » lui dit le chauffeur. Il ne releva pas, s’abstenant de tout commentaire sur sa construction, en 1845, par le commandant du Génie, sur le modèle des mosquées ottomanes. Son taxi longea les arcades pour se garer sur l’ancienne Place Joffre, à deux pas de la fontaine, de « sa chère fontaine ». En lui tendant sa valise, le chauffeur lui montra avec fierté la nymphe sculptée sur le monument : « c’est lacélèbre fontaine AÏn Fouara ». Alors cette fois, la tentation fut la plus forte. Il lança en souriant : « On l’appelait aussi la Fontaine du Marabout ». L’autre se figea de stupeur : « tu connais ça, toi ? ». Il savoura son plaisir avant de répondre : « Si tu savais le nombre de fois que mon père m’a envoyé y remplir des « gargoulettes » d’eau fraîche ! ». Et il se dirigea tranquillement vers son hôtel. L’autre, mi-figue, mi-raisin, le regarda pendant quelques instants s’éloigner.
Il se dit qu’il avait décidément bien choisi. L’hôtel était juste en face du monument et jouxtait la mosquée au minaret ocre de son enfance. Le bâtiment devait avoir une dizaine d’années à peine, un immeuble de six étages, assez élégant finalement, dont les fenêtres des chambres se détachaient en relief sur la façade. Le reste du décor était à l’avenant : familier et nouveau à la fois. Dieu merci, les arbres centenaires de la place était toujours là, majestueux, dominant les cinq lanternes en fer forgé qui se dressaient sur leur piédestal de marbre au dessus de la fontaine. Alors, ce fut plus fort que lui. Il ne put résister. Il tourna les talons, retraversa la rue et s’approcha de la sculpture qui trônait au-dessus du bassin : une femme au corps élancé qu’il retrouva, ému, comme on retrouve une ancienne conquête, identique en tous points à l’image qu’il en avait gardée précieusement malgré toutes ces années écoulées. Elle était assise radieuse, impudique, provocante, ses longs cheveux répandus de part et d’autre de ses épaules, comme pour souligner sa nudité. De la main droite elle se maintenait en équilibre sur son rocher, tandis que de la gauche elle retenait sur sa cuisse une cruche prête à être remplie à l’une des quatre bouches situées chacune en face d’un point cardinal. « Un vrai miracle qu’elle soit encore là », pensa-t-il, en l’admirant presqu’amoureusement, indifférent à l’animation qui l’entourait, comme au bon vieux temps. Il se décida à s’arracher à l’envoûtement et à rejoindre la réception de son hôtel. Le contraste fut rude : le clinquant y dominait. Tapis « oriental » digne des souks pour touristes de Marrakech étalé sur un carrelage noir et gris désassorti, comptoir en demi lune recouvert de faux marbre, collection d’ustensiles en cuivre et en bronze (aiguières, marteaux à sucre, narguilés, moulins à poivre…) exposés dans deux vitrines. L’accueil fut professionnel mais indifférent, ce qui l’étonna et le rassura en même temps : un banal « bon séjour, Monsieur », et la remise de sa clef. Sa chambre était au troisième étage. En se dirigeant vers l’ascenseur, il passa devant une double porte fermée, précédée d’un panneau sur pied annonçant, en lettres blanches sur feutrine marron, un quelconque séminaire professionnel : « Morgan Inc » , « Quality Task Force », « Meeting at 7pm ». Il se demanda s’il devait en rire ou en pleurer.
Sa chambre était anonyme, internationale, fonctionnelle. Il se laissa tomber dans l’unique fauteuil en soupirant: « Et bien voilà, j’y suis ! ». Il n’en revenait pas. Et puis le poids de la fatigue du voyage et de l’excitation qu’il avait fait naître, se fit brusquement sentir. Il se convainquit qu’il ne ferait pas grand-chose du reste de son après-midi. Il préféra s’accorder une petite demi-heure avant de ressortir pour une première balade dans le quartier.
Lorsqu’il retourna près de la fontaine, l’animation y était devenue plus forte, des gamins s’arrosaient près du bassin (« Tiens, les bonnes habitudes ne se sont pas perdues ! »). Il se fondit littéralement dans la foule. Personne ne faisait attention à lui. Il s’était promis de faire un premier pèlerinage en deux étapes qui lui étaient aussi chères l’une que l’autre. Première étape : retrouver l’emplacement de l’ancienne boulangerie de son grand père, comme on recherche une balise. Il décida de s’orienter par rapport à la mosquée mais beaucoup de choses avaient changé : le flot des voitures d’abord, certaines rues modifiées, des maisons rehaussées, des immeubles ajoutés de bric et de broc ..! Les plaques qui, bien sûr, ne lui servaient à rien. Sa maladresse pour se repérer dans ce qui était la ville de sa jeunesse lui fit mal. Et puis tout de même, à un certain moment, en longeant l’ancienne Avenue Jean Jaurès, il replongea d’un coup dans un décor familier : les trottoirs plantés d’arbres et une petite rue à gauche, discrète, comme hors du temps : «mais oui, c’était là, juste à l’angle, je reconnais bien la façade, elle avait un crépi jaune à l’époque, il en reste même des traces. Mince alors, il y a une blanchisserie maintenant et la cour est devenue un parking ». En fait, le charme ne fonctionnait pas, mais il avait besoin de rêver. Alors il rêva. Il sortit quelques photos jaunies de son portefeuille, des photos que son père lui avait données un jour lors d’une de ses visites à la maison de retraite. On le voyait, avec ses sœurs, se livrer, dans cette cour, à un petit commerce de sel, de ce gros sel gris provenant des schotts : un gros sac sur le ventre, ils remplissaient avec une pelle le double décalitre qui servait de mesure. Il sentit ses yeux s’embuer. Il remit à regret les clichés dans sa poche : des vieux l’observaient de loin, à la dérobée, attablés à la terrasse d’un petit café maure, en train de jouer aux dominos devant leurs tasses de kaoua. Il fut tenté, un court instant, d’aller à leur rencontre pour entamer la conversation, leur poser des questions, faire ressurgir le passé. Ils auraient certainement appelé le kaouadji pour qu’il lui amène une tasse et sa petite cafetière à long manche. Et puis, il y renonça, le charme était bel et bien rompu. Il préféra retourner sur ses pas en direction de la seconde étape, plus familière celle-là, celle de la maison où il était né. Impatient, il pressa le pas. Hélas, un nouveau choc l’y attendait : elle était littéralement écrasée par un horrible immeuble de trois étages qui avait anéanti le charmant petit jardin que sa mère soignait avec amour. Il resta figé sur le trottoir d’en-face. Ce fut alors qu’une jeune femme apparut à l’une des fenêtres du premier étage, un balai et un chiffon à la main, et elle lui sourit. Fallait-il y voir une forme d’accueil, de « reconnaissance » ? Tout était encore possible, il avait la phrase au bord des lèvres : « j’ai vécu dans cette maison, madame, et je vous vois faire le ménage de notre ancienne salle à manger… ». Mais à nouveau il manqua de courage, se contentant de lui rendre un sourire un peu triste. Cependant, il ne bougea pas lorsqu’elle réapparut, toujours souriante, secouant son chiffon. Ce fut alors qu’il revit comme dans un flash le grand buffet familial à deux corps qu’il avait bien fallu abandonner en 1962 : un buffet « Art Déco » en chêne massif à quatre portes, ornées de quelques motifs naturels (entrelacs de roses et de grappes de raisin). Sa mémoire se focalisa même sur la porte du haut à droite, où son père rangeait précieusement les bouteilles d’anisette. Il n’avait pas oublié l’étiquette : Flor de Anis, de chez « Gras Frères » à Bab-el-Oued. Et si, (pourquoi pas après tout ?) ce meuble, témoin de tant de fêtes, de réunions, de joies partagées, était tout simplement encore là … Peut-être venait-elle, même, de l’épousseter ? Une nouvelle bouffée de nostalgie l’envahit. Il fut à deux doigts de pousser la porte, et de grimper l’escalier (est-ce qu’il grinçait toujours autant !) pour aller sonner au premier, le cœur battant. Il n’osa pas… Il s’arracha douloureusement au fil ténu qu’il venait de tisser malgré lui, et il partit en retenant ses larmes.
Ce fut presque avec soulagement qu’il retrouva sa chère fontaine. Il eut l’impression (« décidément, je deviens gâteux », pensa-t-il) que la naïade s’était penchée d’un chouïa pour le regarder venir et lui sourire elle aussi. Il faut dire qu’il la connaissait si bien. A commencer par son histoire, apprise dès l’enfance : le succès de sa beauté lorsque son sculpteur, Francis de Saint Vidal, l’avait exposée au Salon des Beaux Arts de Paris en 1898, son adoption par le maire de Sétif de l’époque, son arrivée triomphale au terme d’un voyage épique. Et surtout le véritable coup de cœur qu’elle suscita immédiatement auprès de la population, toutes communautés confondues. Par une journée glaciale d’automne, l’assistance vit s’élever des volutes de vapeur au-dessus du bassin. Stupéfaites, les femmes arabes s’exclamèrent : « Fouara, fouara ! (elle fume comme l’encens !). Le nom devait lui rester, ce nom qu’il continuait, lui aussi, de chérir après toutes ces années : « Aïn Fouara », « La Fontaine qui fume » … Sans oublier le dicton qui va avec (il en était la preuve vivante !) : « qui boira de son eau, un jour y reviendra ».
Ce fut alors qu’il remarqua des traces brunes sur les pieds de la naïade, ce qui lui valut une nouvelle plongée dans le passé. Il se souvint brusquement d’une vieille coutume pratiquée par les femmes arabes : celles qui n’avaient pas encore trouvé de mari venaient demander à la belle de leur en amener un, et si leur vœu était exhaussé, elles revenaient en habits de fête et concert de youyous passer du henné sur les mains et les pieds de leur bienfaitrice.
Il se libéra de cet envoûtement et regagna son hôtel. L’émotion, la fatigue du voyage, le trop plein de sentiments contradictoires, avaient eu raison de l’excitation de son retour aux sources. Il récupéra sa clef dans l’indifférence générale, dîna légèrement à la carte d’une côte d’agneau passe-partout et d’un assortiment de baklavas et de makhrouts, les pâtisseries préférées de sa mère, qu’elle achetait toujours à la sortie de la grand’messe de 10 heures. Et puis, il monta se jeter sur son lit. Il ne tarda pas à sombrer dans un sommeil peuplé de fantômes, alors que le muezzin appelait les fidèles pour Al Icha’a (la cinquième prière).
Il faisait un temps superbe lorsqu’il refit surface le lendemain aux environs de sept heures. Les rideaux bas de gamme de sa chambre laissaient passer généreusement la lumière, et le brouhaha de la place lui parvenait déjà. Il décida de paresser un bon moment, en se laissant imprégner par l’ambiance. En fait, il voulait surtout faire le point et regarder la vérité en face. Ce premier contact, dont il avait tant attendu, lui laissait pour l’essentiel un goût amer. Au lieu d’une plongée dans ce qui avait été l’enchantement de son adolescence, il s’était retrouvé dans une ville en partie méconnaissable, envahie par la circulation, l’agitation, la foule, où la possibilité de croiser des visages familiers, même dans son ancien quartier, où les deux communautés, pourtant, se côtoyaient, était illusoire après toutes ces années. Même son cher Lycée Albertini, devant lequel il était passé la veille, l’avait déçu : moins imposant que dans ses souvenirs, tristounet, défraîchi…Il se prit alors à douter en repensant à toutes les mises en garde dont il avait été abreuvé : ne relevaient-elles pas finalement du simple bon sens ? Et il en vint à envisager de ne donner à son séjour qu’un caractère purement touristique. Et même de l’écourter un peu. Tiens, par exemple en retournant visiter, pourquoi pas, les ruines romaines de Djemila (la Belle), Elles n’étaient, après tout, qu’à 40 km à peine, et il trouverait bien un moyen de s’y rendre, quitte à changer à Saint-Arnaud, au cas où il n’y aurait pas de bus direct. C’était un merveilleux souvenir d’enfance. Il s’y revoyait, en sortie de classe avec ses copains du lycée, regroupés par le Prof d’histoire devant l’Arc de Caracalla, ou détaillant le bestiaire des mosaïques du musée. Sans compter le nombre de fois où son père y avait emmené de la famille ou des amis de passage. Il pourrait même envoyer quelques cartes postales à ses potes de l’association : il jubilait à l’avance en imaginant l’effet produit ! Une autre envie lui vint à l’esprit : aller revoir un endroit, riche de merveilleux souvenirs familiaux : le petit hameau de Mesloug, arrosé par l’unique oued des environs, le Bou-Selam. Il gardait l’image d’un petit bois au bord de l’eau, un des rares coins verdoyants des environs, qui était le rendez-vous incontournable des fêtes de Pâques et de Pentecôte, afin d’y partager entre amis la Mouna, la brioche traditionnelle au parfum de citron et d’orange. Et puis pourquoi ne pas faire un saut jusqu’à Bordj-Bou-Arreridj, comme ça, juste pour voir ce que c’était devenu. Il y avait si souvent joué au foot à la grande époque, et il se souvenait même de leur gardien de but, qui leur donnait à chaque fois du fil à retordre : un certain Slimane, le fils d’un épicier mozabite.
Ragaillardi par toutes ces bonnes résolutions, il s’attarda un peu dans la salle où était servi le petit déjeuner, plaisanta même avec le serveur, auquel son accent n’avait pas échappé, et puis il sortit se replonger avec délice dans l’animation qui entourait déjà son béguin d’enfance, l’envoûtante Aïn Fouara. Avant de se mettre en quête de renseignements sur la meilleure façon d’entreprendre ses petites escapades touristiques, l’envie lui prit de faire un crochet par un autre lieu mythique : le « Marché Couvert ». Il en était à deux pas, cinq minutes à peine, il lui suffisait de remonter l’ancienne rue d’Isly. Il se demanda, en pénétrant dans le bâtiment au toit de tuiles, s’il allait se retrouver, comme autrefois, entouré d’une flopée de petits gosses arabes lui proposant des bottes de garninas, ces petites cardes sauvages enfilés sur des joncs qu’ils ramassaient en gardant leurs chèvres. Ce qu’il ignorait vraiment, par contre, c’est que, dans cette caverne d’Ali Baba, où il plongea immédiatement dans un bain d’effluves de toutes sortes, où dominaient, fort heureusement, les parfums des épices et des herbes aromatiques, un véritable miracle l’attendait, qu’il n’était pas près d’oublier… ! Il le dut tout simplement à sa passion pour les figues. Il faut dire qu’il était rapidement tombé en arrêt devant un étalage, comme il n’en avait plus revu depuis des lustres. Toutes les variétés, toutes les couleurs y paradaient dans des présentoirs tirés au cordeau. Il était comme fasciné. Le « chibani » en djellaba, derrière son comptoir, le regardait en souriant dans sa barbe. Il lui sourit à son tour :
– Ça fait plaisir de revoir des figues comme ça ! Je pense qu’elles viennent de Béni Maouche ?
– Dis-donc, Patron, tu as l’air de t’y connaître !
– Tu parles, si j’cônnais ! (l’accent lui était revenu !). Je venais en acheter ici avec ma mère, quand j’étais gamin.
– Ah bon ! Tu es d’ici ?
– Je suis né pas très loin, près de l’ancien tribunal.
– Vu ton âge, on a sûrement dû se croiser ! Tu veux goûter ? Quelle couleur ?
– Violette…pour commencer !
Tandis qu’il dégustait la chair à la fois fondante et légèrement râpeuse, son interlocuteur, visiblement ravi, y allait de son petit commentaire :
– Quand tu penses que nos figues d’Algérie étaient en péril. Elles étaient bradées aux frontières, pour servir uniquement à entrer dans les quotas de nos voisins à destination de l’union Européenne ! Heureusement que les producteurs de la Wilaya de Bejaia se sont réunis en association et ont créé des coopératives pour relancer les cultures traditionnelles. Sinon, oualou ! Tiens, j’t’en donne une blanche…
Pendant toute cette conversation, il n’avait pas prêté attention à une présence à sa droite. Une présence muette. Un type de son âge, grand, à la belle chevelure blanche, vêtu d’un blazer gris, d’un polo bleu marine et d’un pantalon noir qui tranchaient avec la djellaba du marchand. Le regard amusé du nouveau venu allait de l’un à l’autre. Et soudain, il l’entendit s’exclamer :
– Par le Prophète ! Mais je rêve !
Du coup, il se tourna, au moment où il allait entamer sa troisième figue (une grise). L’homme lui mit la main sur l’épaule, le fixa intensément alors qu’un voile d’émotion passait dans ses yeux :
– Je n’y crois pas ! C’est toi, Pierre !
Et alors tout s’éclaircit, comme dans un flash : le Lycée Albertini, la classe de troisième, le grand type brun au dernier rang, toujours de bonne humeur, un as en math, « milieu de terrain » dans l’équipe de foot. Comment s’appelait-t-il déjà ? Ah, oui : Yacine…Yacine comment ? Mais oui, bien sûr, Yacine Aziz ! Il se sentit envahi par un flot de sentiments au milieu desquels tout venait se bousculer. Ils étaient face à face, son ancien condisciple lui avait pris les mains : ils se dévisagèrent, muets, pendant un court instant, les yeux embués, et puis, spontanément, ils se donnèrent l’accolade sous le regard médusé du vendeur de figues.
La suite se déroula dans un tourbillon, (viens , Pierre, ne restons pas là, il faut que tu me racontes !). Il eut à peine le temps de lancer au marchand : « saha, je repasserai ! ». Yacine l’entraîna au dehors. Il y avait, tout près de là, un café où il avait manifestement ses habitudes. Ils se retrouvèrent attablés en terrasse, le temps seulement de faire signe au kaouadji. Son ancien copain, aussitôt, le pressa de questions :
– Quand es-tu arrivé ? Qu’est-ce qui t’amène à Sétif ? Es-tu venu seul ? …
Alors il se lança et lui raconta tout : son brusque et impérieux désir de revenir, la stupeur de ses proches, leur insistance pour le dissuader, et puis surtout sa déception immédiate, sa plongée dans un décor familier et déstabilisant à la fois, sa sensation de se retrouver désespérément étranger dans un monde indifférent, où il n’avait plus sa place, où il n’était plus » reconnu « , et, pour finir, sa décision d’écourter l’expérience en la limitant à deux ou trois virées strictement touristiques. Yacine le laissa vider son sac, et puis il lui donna une bonne tape dans le dos, comme sur le terrain, au bon vieux temps, après un but marqué ou raté (peu importait !):
– Et bien maintenant, c’est fini ! Tu vas enfin te retrouver chez toi, je vais battre le rappel des copains, ils vont tomber à la renverse ! D’abord, pour commencer, je t’embarque. Je vais tout de suite appeler Leïla sur son portable, pour lui annoncer la nouvelle (tu te souviens, elle était en Première quand nous étions en Terminale). Ça tombe bien, nous avons mon fils Mouloud à déjeuner (il est photographe de presse pour « Le Soir d’Algérie », toujours à droite et à gauche, suivant les évènements !). Elle a prévu de lui faire des boulettes aux amandes, des m’chimeck, tu n’as pas oublié, j’espère ! C’est son plat préféré. On va y aller sans se presser. Nous habitons dans une jolie villa, Cité Tlidjene (excuse-moi : « Cité Lévy » !). Mais tu vas vite reconnaître : c’est près du rond-point avec les quatre réverbères.
Et ils se retrouvèrent ainsi, cinquante ans en arrière, sortant du Lycée Albertini après le cours de math, déambulant dans le centre-ville…Il sentit une grande bouffée de bonheur lui gonfler la poitrine. Il avait bien fait de venir…
Le reste de son séjour fut un tourbillon. Leïla le reçut avec émotion Cité Lévy. Elle avait revêtu, pour la circonstance, une « robe kabyle moderne » (ce fut son fils Mouloud qui tint à le préciser, avec un sourire affectueux, détaillant, en journaliste habitué des présentations de mode les éléments de l’ensemble : « dégradé de bleu et de blanc avec fonda et ceinture assorties, hein qu’elle est belle ma mère ! »). Et c’est vrai qu’elle était restée belle, pensa Pierre en dissimulant son émotion, avec ses yeux de houri en amande dans un visage qui avait résisté au temps. Et puis il y eut le mémorable couscous, bien sûr, avec les anciens du lycée Albertini (devenu Kerouani), que Yacine avait pu rameuter. Les blagues et les souvenirs étaient allés bon train : les beignets achetés à la « récré » de 10h au marchand installé devant l’entrée ; cet ancien élève, un certain Yahia, qui s’était retrouvé puni, accroché aux espaliers du gymnase ; la silhouette redoutée du « Surgé », homme sec, à la moustache alerte, à l’œil toujours à l’affût, mais dont la conversation avait laissé à tous le souvenir d’un homme d’ouverture et de bon sens. Sans oublier, cela va sans dire, l’évocation des exploits des « 3S », les footballeurs du « Sporting Stade Sétifien », qui s’étaient illustrés à Casablanca lors de la demi-finale de la coupe AFN. Autant dire au Moyen-Âge ..! Et toute la bande rigola.
Yacine se mit en quatre pour que le séjour de son ami d’enfance soit au diapason de ses rêves. Il laissa tomber les ruines de Djemila, mais il multiplia les rencontres et il l’emmena revoir le site qui lui tenait tant à cœur : le Mesloug, arrosé effectivement par l’unique oued du pays, le Bou-Selam. Pour être franc, les choses avaient bien changé. La circulation sur la route nationale n’avait plus rien à voir avec celle, paisible, des lundis de Pâques de son enfance. Mais il retrouva avec émotion le petit bois, le pont sur la rivière, l’écho des pique-niques où le rosé de l’oranais accompagnait les tranches de mouna. Et il lui réserva même une surprise, celle de rendre visite à la charmante jeune femme au chiffon à poussière, qu’il n’avait pas osé aborder à la fenêtre de son ancienne maison. Elle le reçut avec gentillesse devant une orangeade, tandis qu’il contemplait médusé le buffet « Art Déco » en chêne massif, sans aller toutefois jusqu’à ouvrir la porte où son père rangeait l’anisette.
Le jour du départ arriva comme dans un rêve. Yacine le ramena à l’aéroport d’Aïn Arnat en début d’après- midi. Alors qu’il attendait, la gorge un peu nouée pour passer en salle d’embarquement, le fils de son ami arriva essoufflé, un paquet à la main.
-Tenez, c’est pour vous, souvenir, attendez pour l’ouvrir d’être chez vous.
On appelait les passagers pour Marseille. Yacine était grave. Ils ne dirent pas un mot en se donnant l’accolade. Il partit sans se retourner.
Une fois installé dans son fauteuil, il évita de trop regarder le décor qui le retenait encore. Il baissa le rideau de son hublot dès le décollage et ferma les yeux. Il ne consentit à les rouvrir que lorsque l’hôtesse annonça la descente sur Marignane.
Le temps était superbe sur Marseille. Il prit un taxi pour rejoindre son immeuble du Prado. Le voisin du rez-de-chaussée le regarda entrer :
-Tiens, vous voilà de retour, Monsieur Boisron.
Il grogna une réponse inaudible en appelant l’ascenseur.
Arrivé dans son appartement, il abandonna sa valise dans un coin et ouvrit toute grande la porte fenêtre de la terrasse. Il se sentait comme groggy, désorienté. Il se laissa tomber dans son fauteuil favori, face à la mer, face à « là-bas ». Ce fut alors qu’il prit conscience, qu’il avait gardé à la main le paquet offert par le fils de Yacine. Il le tata machinalement. Cela ressemblait à un sous-verre. Il le sortit, non sans mal de l’enveloppe-bulle, le retourna et resta figé devant la photo. Il s’en souvenait maintenant : Mouloud, qui avait accompagné le groupe d’anciens copains de lycée, devant « sa chère » fontaine, avait fait le vide des gamins qui y barbotaient, pour immortaliser les retrouvailles.
Il contempla longuement le cliché. La naïade inclinait la tête vers lui et lui souriait.
Alors toute la tension, toute l’émotion, accumulées se relâchèrent brusquement. Les bondes qui l’oppressaient s’ouvrirent et il éclata en sanglots, le visage penché sur le cliché serré sur ses genoux.
Ses larmes coulaient sur le sous-verre. L’une d’entre elles tomba sur l’embouchure de la cruche que tenait la jeune femme. Et ce fut à cet instant qu’il s’entendit murmurer à deux reprises :
Aïn Fouara, mon Amour…